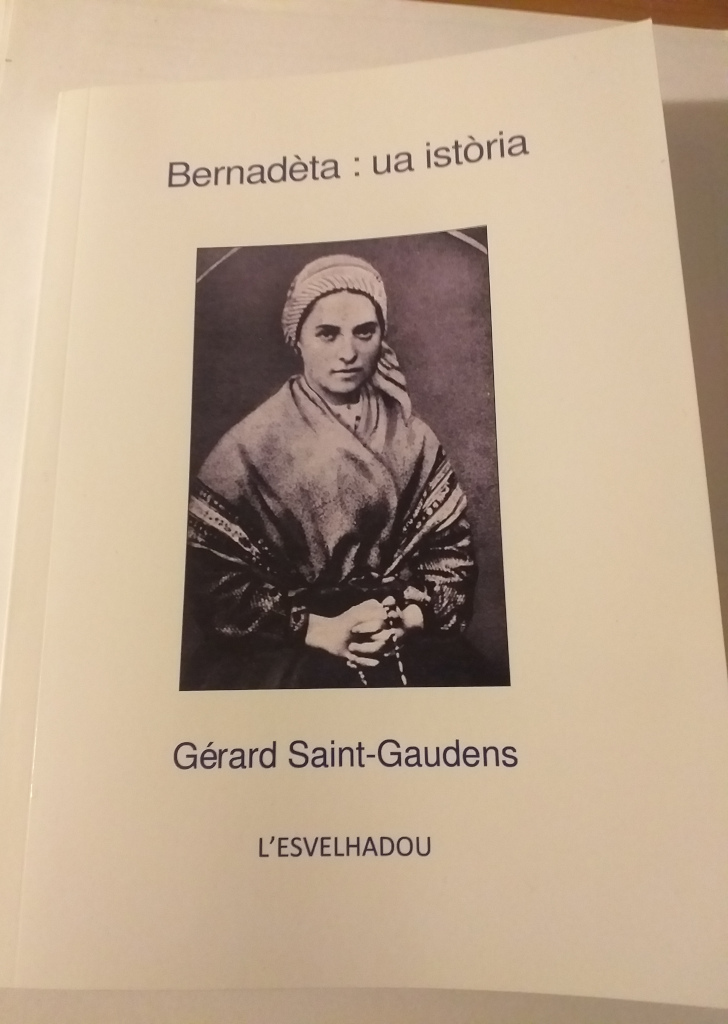Le blason et le drapeau.

La Dame de Brassempouy et l’emblème pour la Gascogne.
Dans notre société mondialisée d’aujourd’hui où l’image prévaut en support de l’information, chaque pays, chaque région, arbore un emblème déployé en marqueur identitaire, en jalon territorial et en vecteur de communication.
Rien, jusqu’à présent n’a jamais attesté qu’au cours de son histoire la Gascogne ait possédé un drapeau ; sous Louis XIV un blason [1] lui a été attribué d’office pour des raisons financières. cependant un blason ne remplace pas un drapeau.
Au cours des dernières années divers projets de drapeau gascon sont apparus pour pallier à une carence d’emblème perçue comme l’une des principales causes de l’anonymat dans lequel la Gascogne se trouve plongée aujourd’hui.
Pour répondre à une (faible) demande certains fabricants de drapeaux ont utilisé, en dépit des règles de l’héraldique et de la vexillologie, le blason gascon pour confectionner une pièce hybride qui n’est ni un blason, ni un drapeau et qu’on dénomme une bannière armoriée.
Le blason et le drapeau sont des pièces de nature différente qui ont des emplois distincts et ne peuvent, en aucun cas, être utilisés en commutation l’un de l’autre.
Drapeaux divers.
D’autre part, divers projets d’emblèmes ont été proposés ; à l’exception d’un modèle, plus pensé, présentant un triangle rouge évoquant la forme géométrique du territoire gascon, presque tous présentaient divers modèles de croix, croix centrée [2], croix latine, croix dite de « saint André », croix des Mousquetaires….
Les signes cruciformes, croix grecque, croix celte, triskèle, swastika, étoile, roue, rouelles, etc… sont, à l’exception des croix latine et de saint André, les dérivés du culte solaire apparu à l’aube de l’âge du bronze chez les indoeuropéens [3].
La croix latine qui symbolise l’instrument de supplice romain sur lequel mourut le Christ et la croix de Saint-André, n’apparurent que très longtemps après avec le christianisme.
Tous ces signes étaient inconnus des Aquitains qui se différenciaient des Indo-européens, non seulement par leur physique et par leur langue [4] , mais également par une ethnoculture spécifique.
Conséquemment, proposer un drapeau arborant un symbole étranger aux origines culturelles de la Gascogne n’est pas le meilleur moyen de l’identifier et de la faire émerger de son anonymat.
La croix centrée blanche sur fond rouge
En plus des projets d’emblèmes pour la Gascogne porteurs de signes cruciformes, dérivés du culte solaire indoeuropéen, il a été notamment proposé une bannière cultuelle frappée d’une croix centrée blanche sur fond rouge qui, selon la légende, aurait été accordée par le Pape aux formations de pèlerins gascons en partance pour la troisième croisade.
Or, cette interprétation de l’histoire ne correspond pas à la réalité.
Lors des deux premières croisades les formations de pèlerins, quelle que soit leur nationalité, furent réunies sous une bannière commune portant une croix centrée de couleur rouge sur fond blanc ; par contre, lors de la troisième croisade, afin de distinguer les formations entre elles, il leur fut attribué des bannières dont les couleurs de la croix variait avec la nationalité ou l’origine régionale ; ainsi, les Flamands eurent droit à une bannière blanche avec une croix centrée verte, les Italiens à une bannière blanche à croix centrée jaune et les Bretons à une bannière blanche à croix centrée noire ; les Anglais reçurent une bannière blanche à croix centrée rouge et les Français héritèrent d’une bannière rouge à croix centrée blanche qui fut leur premier drapeau national ; il devint bleu à croix centrée blanche pendant la guerre de Cent ans [5].
Ainsi, faute d’avoir reçu une bannière qui les particularise les pèlerins gascons partirent pour la troisième croisade non sous leur drapeau, mais sous celui de la monarchie française.
La Daune [6].
L’appétence pour la réapparition matériellement ostensible de la Gascogne aux yeux de tous est à l’origine de la création d’un drapeau que son originalité et son unicité rendent fortement mémorisable.
L’emblème à la Daune, composé en observation des disciplines de la symbolique, de l’esthétique et de la vexillologie arbore les symboles historiques fondamentaux de territoire, de population et d’identité culturelle qui authentifient la Gascogne en pays de facto.
Le triangle rouge représente le territoire gascon, la Dame de Brassempouy personnifie la population et les couleurs blanc et rouge évoquent l’héritage culturel.
Ces repères concordent avec l’histoire d’une Gascogne qui s’explique, en plus de ses fondamentaux ethnosociétoculturels, par les millénaires antérieurs à la conquête romaine ; centre territorial de l’espace aquitano-pyrénéen, elle est l’un des plus anciens pays aquitains sur le territoire duquel au cours des temps, les populations qui nous y ont précédés ont développé une ethnoculture spécifique dont nous sommes les héritiers.
La présence de la Daune sur l’emblème authentifie les origines protohistoriques de la Gascogne.
Chef-d’œuvre universellement célèbre pour être la première représentation sculptée connue au monde d’un visage humain, cette effigie sculptée plusieurs dizaines de millénaires avant l’apparition de la statuaire chez les grandes civilisations moyennes-orientales et asiatiques, ancre la Gascogne au cœur d’une humanité qui s’est dégagée de l’état préhistorique par sa créativité artistique.
Étrangement, ce visage, d’une facture étonnamment moderne, semble se corréler à certains aspects sociétaux gascons.
Figure féminine, elle rappelle d’une manière particulière l’ancienne tradition de l’égalité entre la femme et l’homme qui a honoré la société gasconne dans un monde où, encore de nos jours, ce principe pose problème.
La coiffure caractéristique à laquelle elle doit son surnom de Dame à la Capuche anticipe par son apparence sur le capulet, coiffe que les femmes pyrénéennes portèrent jusqu’à l’aube du XXe siècle.
Cette figure symbole de la population de la Gascogne, a été délibérément orientée de profil vers le guindant [7]
dans le sens expressif de la marche en avant d’un pays porteur pour l’avenir de valeurs dynamiques.
Le triangle rouge a été emprunté à un drapeau notoirement antérieur au drapeau à la Daune ; représentation géométrique du territoire gascon il manifeste la volition de sa réunification dans ses limites naturelles et linguistiques comprises entre le littoral atlantique (côté vertical du triangle) le cours de la Garonne (la diagonale du triangle) et la chaîne pyrénéenne (base du triangle).
Le rouge et le blanc du fonds du drapeau sont les couleurs traditionnelles de la Gascogne.

La conception de l’emblème dénommé la Daune par tous ceux qui l’ont adopté, a été très influencée par le propos du grand historien Fernand Braudel qui, dans son ouvrage L’identité de la France [8] écrit, après avoir cité Jean Markale [9] , Ne dîtes pas que la préhistoire n’est pas l’histoire. Ne dites pas que la Gaule n’existe pas avant la Gaule ou que la France n’existe pas avant la France, que l’une et l’autre ne s’expliquent pas, en plus d’un de leurs traits, par les millénaires antérieurs à la conquête romaine.
Or, la France est un État qui s’est constitué en nation par la conquête de territoires et de peuples qui l’ont précédée dans le temps et dans l’espace.
La Gascogne est le paradigme de ces territoires et de ces peuples qui ont contribué à doter la France de la « notoriété archéologique » [10] qu’elle leur doit.
La réalité de sa préhistoire et de son histoire autorise à dire que la Gascogne a existé bien avant la Gascogne et qu’elle s’explique en plus de ses fondamentaux ethno-sociétaux-culturels par les millénaires antérieurs aux conquêtes romaine, française et anglaise.
Elle a aussi changé de nom plusieurs fois ; l’espace aquitano-pyrénéen dont l’actuel territoire gascon constituait le centre fut d’abord dénommé Aquitaine, avant de devenir la Novempopulanie dont les limites correspondaient à peu près à celles de la Gascogne d’aujourd’hui, puis de prendre le nom de Gascogne qu’elle porte depuis l’invasion des Vascons pyrénéens.
Une coiffe d’exception ?
Un modèle de coiffe identique à celui de la Daune, daté de 3800 ans avant J.C. et réalisé des millénaires après celle de Brassempouy a été découvert en Italie dans la région du Vésuve. (Science et Avenir. Janvier 2002. P.16) ; il s’agit d’une coiffe réalisée par l’assemblage de lames taillées dans des défenses de sanglier.
La rareté de l’ouvrage, le travail inhérent à la récolte des nombreuses petites plaques, à la précision de leur taille et de leur assemblage, ainsi que le poids de la coiffe qui devait en rendre le port assez pénible, peuvent donner à penser qu’il ne s’agirait pas de la coiffure journalière des femmes de l’époque, mais possiblement d’une coiffure de « fête » ou bien destinée à distinguer traditionnellement une personne d’un certain rang sociétal..
……….
Le modèle du drapeau à la Daune a fait l’objet d’un dépôt à l’Institut de la Propriété Industrielle de Paris ; néanmoins, sa reproduction est autorisée sous réserve de rester conforme au modèle déposé.