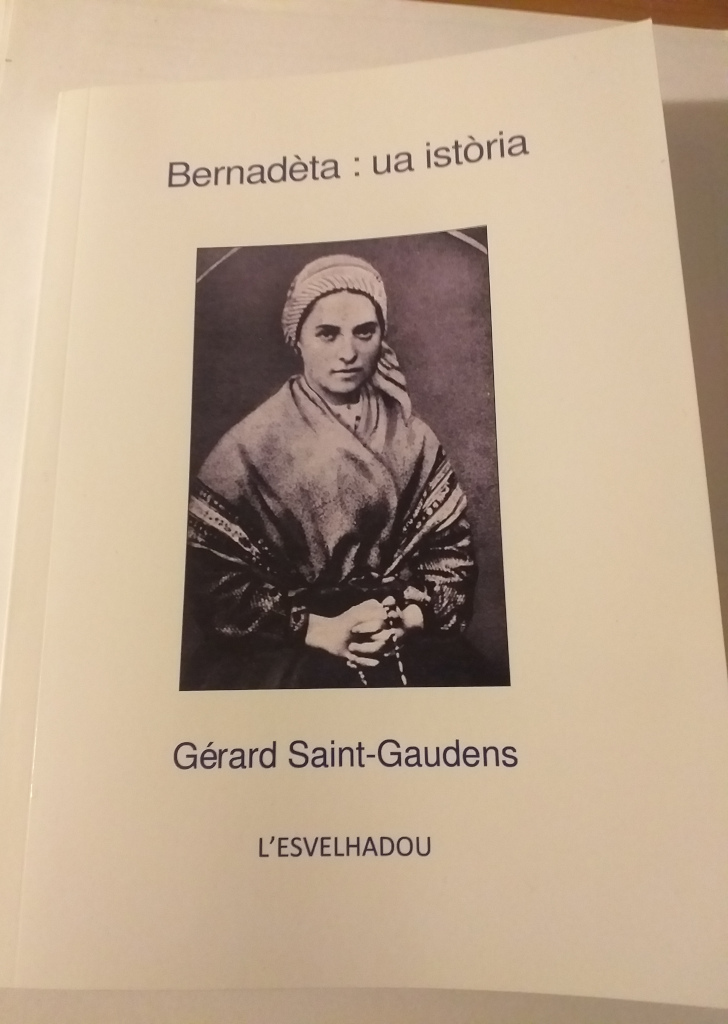Où était-il, l’eldorado des Aquitains ?
A Saint-Domingue (devenue depuis "Haïti"), soit la partie occidentale de l’Ile d’Hispaniola [1].
Le titre complet de l’ouvrage est "L’eldorado des Aquitains - Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d’Amérique (XVIIe - XVIIIe siècles)" (Editions Atlantica, 1998).
Et qui étaient les "Aquitains" ?
L’énumération "Gascons, Basques et Béarnais" est une approximation : dans "Aquitains", l’auteur place tous les colons de Saint Domingue originaires du vaste arrière-pays des ports de Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, qui assuraient leurs départs et éventuellement leurs retours.
Donc, les colons saintongeais, périgourdins, guyennais... en faisaient partie.
Les grandes familles commerçantes bordelaises ont aussi beaucoup compté dans la colonisation de Saint Domingue, et leur gasconnité n’est pas toujours forte.
Bref, l’Aquitaine dont il est question ici, c’est plus une région géographique qu’une région ethnique, plus "Guyenne et Gascogne" que "l’Aquitaine de César" au sud de Garonne.
De ce vaste ensemble aquitain sont venus, d’après les estimations de l’auteur, au 18e siècle, environ 40% des colons français à Saint-Domingue.
C’est beaucoup pour un ensemble régional qui ne comptait peut-être que 10% de la population française.
Admettons que dans cet ensemble "aquitain", les gascons (au sens large, en incluant les béarnais mais pas les basques) pesaient pour moitié... Cela donne un poids gascon d’environ 20% dans la colonisation de Saint-Domingue à l’âge d’or de la colonie.
C’est beaucoup aussi par rapport au poids de la Gascogne dans la population française.
L’abondance de patronymes gascons (Peyré, Castéra...), à la fois dans les archives parcourues par l’auteur, et dans les noms haïtiens d’après l’indépendance, en est une trace : dans la liste des présidents d’Haïti, on trouve Philippe Sudré Dartiguenave et Sylvain Salnave...
Mais 20% de gascon, c’est finalement trop peu pour que Saint-Domingue ait été une "nouvelle Gascogne" ethnique, même si le nom "Gascogne" y a formé des toponymes [2].
Il faudrait aussi rechercher des traces de gascon dans le créole haïtien. Pas sûr qu’il y en ait...
Mais n’oublions pas que 90% de la population de Saint-Domingue était constituée par les esclaves noirs - c’est à la fois ce qui a fait la richesse de la colonie, et ce qui a causé sa perte, avec la révolte des esclaves, à partir de 1791 jusqu’à l’indépendance haïtienne.
Et le cadre administratif de Saint Domingue était l’ancien régime français, avant de subir à sa manière, pendant les dernières années coloniales, les soubresauts de la Révolution française.
L’auteur Jacques de Cauna sait tout cela, mais est attentif aux réseaux familiaux, aux solidarités de "pays" ou de villes, si nécessaires aux colons dans leur lutte éperdue pour se faire une place à Saint Domingue, et peut-être (pas souvent, en fait) y faire fortune.
Même le leader (et finalement gouverneur) noir Toussaint Louverture profitait d’un réseau "aquitain" !
Dommage que Napoléon ait envoyé une armée pour le renverser, à l’appel des colons qui réclamaient le retour de l’esclavage. Opération "qui coûta la vie à plus de 150 000 français et vraisemblablement le double d’haïtiens"...
Louverture a bien été renversé, mais l’armée de Napoléon a été battue par l’armée noire de Dessalines qui a massacré méthodiquement les derniers milliers de blancs pur sucre [3] de Saint Domingue.
Voeu final de l’auteur J. de Cauna :
"Peut-être les Aquitains qui ont eu, à coup sûr, la meilleure part - dans tous les sens du terme - dans une si riche histoire, ont-ils encore aujourd’hui un rôle important à jouer dans sa transmission..."
C’est le rôle tenu par la présente note de lecture.